Les limites exactes du Moyen Âge ainsi que le découpage en différentes périodes sont discutées et font encore l'objet de débats entre historiens. En France, on estime traditionnellement que le début du Moyen Âge coïncide avec le baptême de Clovis, le 25 décembre 498 (date elle-même discutée). La fin du Moyen Âge est généralement située vers 1500. Ces dates ne pouvant jouer qu'un rôle symbolique dans un changement d'époque, qui est en fait un processus dilué dfans le temps.
I
La Médecine occidentale au début du Moyen Âge
Qu’ils soient médecins titrés ou simples chirurgiens artisans, les uns comme les autres sont encore peu nombreux et les soins aux blessés et aux malades sont souvent dispensés par d’autres : les religieuses et les moines distribuent des remèdes à leurs fidèles, les seigneurs et leurs épouses soignent les gens de leurs domaines. Dans les villages exercent les rebouteux, les rhabilleurs, les herniers; les matrones expérimentées mais sans instruction, qu’on nomme ventrières, pratiquent les accouchements.
Chanoîne médecin et les premiers hôpitaux
A partir du Ve siècle, les grandes invasions (Huns, Francs, Lombards, Normands) plonge l’Europe dans le désordre. Suite aux invasions barbares, le savoir, c'est-à-dire les manuscrits anciens sont conservés dans les monastères hérités de la maison mère du Mont-Cassin fondée par saint Benoit de Nurcie (480-527). La copie calligraphiée fut une des principales activités monastiques que ce soit par les Bénédictins puis par les moines de Cluny, de Citeaux et de Clairvaux qui essaimèrent rapidement en France, en Bourgogne, en Provence et dans les pays germaniques. Le clergé est peu instruit des choses de la médecine et la médecine conventuelle ne sera faite que de transmission sans capacité créative. Quelques clercs ont néanmoins laissé leurs noms comme Boèce (480-524) ou Isidore de Séville (570-636). L’Eglise devient dépositaire du savoir, mais ne le fait pas évoluer. La médecine n’est plus un art à part, elle fait moins l’objet d’investissement. Les moines connaissent donc aussi bien la théologie, les mathématiques, la botanique, l’architecture et la médecine. La médecine n’est pas dans la plupart des cas exercée par des personnes à qui cet art est réservé.
Les premiers médecins sont donc des clercs (entrés dans l’état ecclésiastique) qui ont accès à la connaissance. De plus, avec la propagation de l'évangile, le sens chrétien de la charité passe par le soin du prochain et si possible la guérison du malade. Aussi, il est logique que de nombreuses fondations caritatives soient dirigées par des religieux. Il faut remonter au IVème siècle pour trouver le premier hôpital cité dans un texte : le "Nosokomeion" (endroit où l'on soigne), fondé par une noble dame romaine, Fabiola. Cette évolution était d’autant plus inévitable que, conformément à la tradition byzantine les hôpitaux étaient considérés comme une des œuvres majeures d’assistance chrétienne et établis de ce fait à l’ombre des couvents ou des cathédrales.
Dès l’an 651, à Paris, l'Hôtel-Dieu, près de Notre-Dame, accueille les pauvres, malades ou non; il est ouvert aux malades en 829 et restera à la charge entière du clergé jusqu’en 1505. C'est aussi à l'ombre de l'église cathédrale, à "l'école canoniale", que se forment les médecins.
Avec Charlemagne (742 - 814) , l'enseignement de la médecine est donné dans les écoles palatines; dans le cartulaire de Thionville daté de 805, il est fait clairement mention de l'art de guérir. La science médicale fait partie intégrante de la formation des élèves.
Instruit par la tradition populaire ou par la lecture assidue de quelques vieux herbiers, les moines sélectionnaient et cultivaient jalousement dans les paisibles “hortuli” des cloîtres, les simples qui formaient l’essentiel de leur pharmacopée. Le goût monacal de la botanique s’est perpétué jusqu’au XIX e siècle et à Gregor Mendel.
Pendant longtemps les ordres religieux seront ainsi seuls en mesure d’assurer les soins. Plusieurs d’entre eux se spécialiseront dans cette activité charitable donnant naissance aux grands ordres hospitaliers :
- les Antonins (1095),
- ordre du Saint-Esprit (1178),
- ordre des Porte-Croix (1160),
- ordre de Saint-Lazare (1187),
- et l’ordre des Chevaliers Teutoniques (1197).
Un des plus actifs fut celui de Saint-Jean de Jérusalem (1100) transféré à Saint-Jean d’Acre puis replié à Rhodes.
La médecine conventuelle des premiers siècles du Moyen Age fut avant tout une œuvre humanitaire admirable. Mais si l’on fait abstraction de ses mérites spirituels et sociaux , son incidence scientifique a été négligeable. Sur le plan documentaire, elle a seulement permis la survie partielle et stérile de quelques vieilles notions éparses que rien n’est venu compléter ni enrichir. Sur le plan pratique, son efficacité était lamentablement restreinte : la bonne volonté de ceux qui prodiguaient leurs soins ne compensait pas malheureusement un profond défaut de connaissances.
II
Deux fenêtres ouvertes sur le passé et sur l’avenir : Salerne et Montpellier
Ecole de Salerne
Entre la chute de l'Empire romain et la Renaissance, l'école de Salerne joua un rôle inestimable dans l'histoire de la médecine.
Il faudra attendre le XIe siècle, pour que, dans le petit port de Salerne, en Italie, renaisse une école de médecine. Deux faits méritent d’être soulignés :
- d’une part on y traite que de médecine
- d’autre part les enseignants ne sont pas des clercs, mais des laïques exerçant la médecine.
Pendant plusieurs siècles l’Italie du sud sera ainsi le lieu de ce que l’on pourrait appeler la Renaissance de la médecine.
L’heureuse fortune de Salerne, la “Cité Hippocratique”, est attribuée à sa position géographique privilégiée. Edifiée dans un site naturel d’une rare beauté, elle se trouvait effectivement au point de jonction des deux grandes civilisations antiques: celle de la Grèce, dont les ruines de Paestum portent l’impérissable témoignage, et celle de Rome, dont les opulentes cités qui jalonnent la voie Appienne ont longtemps gardé la marque. Elle était naturellement ouverte aux précieux échanges méditerranéens. Une légende veut d’ailleurs que cet illustre foyer médical ait été fondé conjointement par un grec, un Italo-romain, un Juif et un Sarrasin qui se seraient appelés respectivement Pontus, Salernus, Helinus et Adela.
Toujours est-il que Salerne était dotée d’un hôpital bénédictin dès le VII e siècle et que la création de son école de médecine est antérieure à 846. La renommée de ses médecins laïcs était déjà grande à la fin du IXe siècle. En 904, Charles le Simple, roi de France , fait appel à un praticien de Salerne; en 984, l’évêque de Verdun, Aldaberon, se rend sur place pour y demander consultation. La rivalité locale entre clercs et laïcs fut de brève durée. Les religieux se regroupèrent à une quarantaine de lieues plus au nord, autour de l’abbaye du Mon-Cassin, afin d’y poursuivre leur paisible labeur, tandis que les médecins séculiers organisaient dans la ville une école indépendante dont l’influence et la répûtation allèrent en croissant jusqu’au XIIe siècle. Le collège comprenait dix medecins avec à leur tête un doyen ou “praepositus”; beaucoup des étudiants étaient Juifs. l’enseignement théorique s’aidait de manuels composés avec des fragments de textes anciens, portant surtout sur la thérapeutique hippocratique. Les études pratiques avaient lieu à l’hôpital. Jusqu’au XIe siècle l’influence judéo-arabefut relativement peu sensible. Sans mériter encore le nom d’université, l’école de Salerne n’en était pas moins une saisissante préfiguration.
Les premiers maîtres:
Le premier des grands salertinains fut un Lombard nommé Warbod Gariopontus; il écrivit le Passionarius en cinq livres. Cette compilation d’Hippocrate, de Galien et plusieurs autres médecins de l’Antiquité utilise pour la première fois un vocabulaire médical latinisé. Deux autres médecins, Ragentifrido et Gruniwald, ont également joui d’un certain renom.
Alphanus Ier, archevêque de Salerne, composa un Premnon Medicon et un De quator humoribus corporis humani, d’inspiration galénique. De Petroncello dans la Practica fait une place importante à l’hydrothérapie froide.
La participation des femmes à l’activité de l’école est certaine. La fameuse Trotula est contestée par certains. Pour d’autres il s’agirait bien d’une sage-femme experte. D’autres femmes médecins excercèrent à Salerne : Constantia Calenda, Rébecca Guarna et Abbela.
La médecine salertinaine
L’œuvre des premiers médecins salertinains fut le plus souvent collective et anonyme. Il en est ainsi du Seculum hominis un poème didactique et de l’Antidotarium un recueil général.
Anonyme et collectif également le célèbre Flos medicinae vel regimen sanitatis salernitanum; ce poème de médecine pratique constitue la bible de l’école, guidant le métier des médecin. Il traite de l’alimentation, de l’hygiène, de l’activité sexuelle…
Le Regimen Sanitatis a connu un succès prodigieux et durable : il figure jusqu’à la fin de la Renaissance parmi les textes fondamentaux de la littérature médicale. L’ouvrage aurait eu plus de 200 éditions et traductions en plusieurs langues.
L’autre grand ouvrage de l’école est représenté par le De aegritudinum curatione, une vaste encyclopédie divisée en 173 chapitreset composée par un rédacteur anonyme du XII e siècle. L’influence arabe y est notable. Elle reflète surtout l’opinion des sept plus grands maîtres de l’école : Jean Platearius, Caphon, Petronius, Afflacius, Bartholomeus, Ferrarius et Trotula. D’autres médecins Urvus, Archimatteus, Bernard le Provençal, Richard de Salerne et l’archevêque Romualdus Guarna figurent parmi ceux qui ont contribué à l’éclat de l’école entre 1150 er 1200.
L’influence arabe pénétra largement à Salerne, elle enrichit considérablement la doctrine de l’école et stimula son activité. Son principal propagateur en fut Constantin l’Africain, un médecin chrétien de Carthage rompu aux langues orientales.
La médecine salertinaine est à son apogée en 1140 lorsque Roger de Sicile assure l’école de sa protection. Fait fondamental, l’enseignement de l’anatomie sur le cadavre est introduit pour la première fois dans le programme de l’école, sous caution de la foi. En 1267, Charles Ier d’Anjou confirmera les droits et prérogatives des médecins de Salerne.
Le Bénédictin Pierre-Gilles de Corbeil, qui passa par Montpellier et enseigna ensuite à Paris où il devint le médecin de Philippe Auguste fut élève à l’école de Salerne pour laquelle il composa un grand poème didactique traitant de l’ensemble des problèmes médicaux.
Vers 1160, un premier groupe d’enseigneuers et de praticiens quitte Salerne pour le Languedoc (Rinaldo, Mathieu Salomon).
Benvenuto Graffeus, un italien chrétien né à Jerusalem professa à Salerne pis à Montpellier, est célèbre pour son traité d’ophtalmologie. Deux chirurgiens ont particulièrement illustré l’ultime période de l’école salertinaine : Ruggiero di Frugardo et Roland de Parme.
L’école de Salerne jouissait encore au XVe siècle d’une bonne renommée. Cent ans plus tard, Paracelse y fait une brève halte au cours de son périple européen. Tombée dans l’oublielle ne survécut que de nom jusqu’à sa suppression officielle prononcée par un décret de Napoléon Ier le 28 novembre 1811.
La contribution effective de Salerne au développement de la médecine est relativement modeste et son importance fut manifestement exagérée. Elle fut néanmoins la première tête de pont culturelle entre l’Orient et l’Occident et favorisa le retour du patrimoine grec et l’importation des travaux originaux byzantins et arabes.
Ecole de Montpellier
La Faculté de médecine de Montpellier, est la plus ancienne en activité du monde, l'école de médecine de Salerne ayant disparu au début du XIXe siècle (décret du 29 novembre 1811)
Fondée au Xe siècle, la cité de Montpellier qui relevait de l’évêque de Maguelonne, tomba sous la suzeraineté des Papes à partir de 1085. Elle passa sous celle des rois d’Aragon et de Majorque de 1204 à 1349 et ne devint définitivement française qu’en 1382 sous Charles VI.
L'origine
L'origine de la Faculté se confond avec l'essor de la ville commerçante : c'est le "mons pistillarius" ou montagne des épiciers. La position géographique de la ville de Montpellier, au bord du golfe du Lion, lui permet d'être le trait d'union entre la France et les populations riveraines de la Méditerranée.
En 1181, Guilhelm VIII, seigneur de Montpellier décide que la faculté sera ouverte à tous, sans restriction et sans distinction de confession ou d’origine. L’Eglise n’en conservait pas moins la haute main sur la nouvelle Université, mais sa tutelle était plus large et plus compréhensive qu’ailleurs. Sa devise s'inspire de la tradition hippocratique dont elle se réclame : "Olim Cous nunc Monspeliensis Hippocrates" ("Jadis Hippocrate était de Cos, maintenant il est de Montpellier")
Au Moyen Âge
Le 17 avril 1220, le Cardinal Conrad d'Urach Légat du pape Honorius III, concède à l'« Universitas medicorum » ses premiers statuts. En fondant officiellement la Faculté de Montpellier, il ne fit que consacrer un centre de pratique et d’enseignement réputé depuis près d’un siècle. Adalbert de Magonza étudiait déjà la médecine à Montpellier en 1153. Vers cette époque, Frère Gui y fondait l’hôpital du Saint-Esprit, un modèle du genre en Europe, dont le Pape Innocent III tint à s’inspirer en Italie.
Puis, le 26 octobre 1289, le pape Nicolas IV adresse, depuis Rome, la constitution apostolique "Quia Sapientia" à tous les docteurs et étudiants de la ville de Montpellier, créant ainsi officiellement l'université de Montpellier regroupant le Droit, la Médecine, les Arts et la Théologie; le Pape Nicolas IV ne reconnaît le droit de conférer les grades qu’à une seule école, qui prend le titre de Faculté de médecine, les autres pouvant seulement dispenser l’enseignement.
L’Eglise n’en conservait pas moins la haute main sur la nouvelle Université, mais sa tutelle était plus large et plus compréhensive qu’ailleurs. Ainsi, dès 1309, Clément V autorisera les maîtres et les étudiants à contracter mariage, alors que les professeurs de Paris n’obtiendront cette même latitude qu’en 1452, et les clercs tonsurés en 1600 seulement.
L'École de médecine jouit d'un grand prestige ayant la réputation d'avoir hérité du savoir des Arabes et des Juifs, elle accueille des étudiants de toute l'Europe.
Comme Salerne, Montpellier s’est placée dès l’origine sous le signe du libéralisme hippocratique. Elle a précocement été animée par le courant médical méditerranéen; elle a bénéficié dès ses débuts d’un double apport : juif et hispano-mauresque d’une part et italo-salernitain d’autre part. Son indépendance scientifique a été une conséquence des remous politiques qui ont agité les premiers siècles de son histoire.
Cet esprit d’indépendance s’est manifesté au cours des siècles par plusieurs conflits armés. Il s’est reflété dans l’accueil fait aux divers émigrants venus d’Espagne, dans l’essor du mouvement des Cathares albigeois, qui fut finalement noyé au XIIIe siècle dans le sang de la croisade et le feu des bûchers collectifs. Il se retrouvera plus tard, au lendemain de la Réforme calviniste. Il rend également compte de cette relative tolérance et de ce souci d’objectivité qui caractériseront longtemps l’école de Montpellier. Celle-ci s’opposera par là à la Faculté de Paris, plus intransigeante, plus étroitement portée aux attitudes conservatrices et plus rigoureusement attachée aux dogmes théologico-philosophiques.
Il n’est pas douteux que l’enseignement médical est beaucoup plus ancien à Montpellier qu’à Paris, au XIIème siècle Paris n’était guère connu que pour sa Faculté de Théologie.
L’enseignement médical montpelliérain
Le corps enseignant avait à sa tête un chancellier, nommé par l’évêque, ses fonctions étaient comparables à celles de nos doyens actuels. A partir de 1369, Urbain V dota la Faculté d’un local, celui du Collège du Pape ou des Douze Médecins. A la fin du XVe siècle, elle comprenait en outre le Collège Royal. Elle occupe de nos jours d’anciens locaux conventuels, au pied de la cathédrale Saint-Pierre dont ses professeurs sont traditionnellement chanoines.
Jusqu'au début du XIVe siècle, les cours sont dispensés au domicile des Régents, qui étaient rétribué directement par ses élèves; seuls les actes sont réalisés dans l'église Saint-Firmin (détruite en 1562 par les Réformés, elle ne fut jamais reconstruite).
Une subvention royale (Charles VIII et Louis XII) permit à l’Université d’établir un budget régulier. Les méthodes et le matériel d’enseignement étaient analogues à ceux dont Salerne avait propagé l’usage. Après avoir accompli une scolarité de trois ans, le philiatre pouvait postuler le baccalauréat en médecine. Venait ensuite la licence; celle-ci comportait plusieurs épreuves soutenues en présence de l’ensemble des professeurs à l’église Saint-Firmin ou à Notre-Dame-des-Tables : des “disputationes per intentionem” suivies du développement des deux “points rigoureux” extraits de l’Ars Parva de Galien et des Aphorismes d’Hippocrate.
Au début du XIIème siècle le Pape Honorius III, voulant concurrencer l’École de Salerne en Italie, eut l’idée de mettre la main sur l’École de Montpellier et décide que le diplôme de Maître régent permet d’exercer la Médecine dans le monde entier, "hic et ubique terrarum". Elle comprend deux sortes de maîtres: les uns enseignant la médecine salernitaine, les autres celle de langue arabe, mais en 1148 de nombreux médecins juifs, chassés d’Espagne, étant venu s’y réfugier, l’influence arabe s’y fait de plus en plus sentir et la médecine est de plus en plus entre les mains de médecins espagnols (issus de l’arabisation: voir mon sujet sur les médecins arabes).
L’ “inceptio” était alors conférée au candidat par l’évêque ou par son mandataire, le prieur de Saint-Firmin, ce qui lui donnait le droit d’exercer ‘hic et ubique terrarum” (permettant d’exercer la Médecine dans le monde entier); le diplôme revêtait de ce fait un caractère d’universalité. Les chirurgiens étaient toutefois dispensés de cet examen. La troisième et dernière étape était celle du doctorat “de la grande manière”, mérité par les épreuves des “triduanes” et consacré par la cérémonie pompeuse du “triomphe”. Dans l’église Saint-Firmin, l’impétrant recevait le bonnet noir et la ceinture dorée, attributs d’un grade qui lui conférait désormais le droit d’enseigner; le tout s’achevait dans un banquet, parmi les cadeaux qu’il était d’usage d’offrir aux maîtres.
Illustres enseignants
La renommée de la médecine à Montpellier est alors considérable. Parmi les enseignants, d'illustres savants occupent les chaires
Durant les trois premiers siècles de son existence, l’école de Montpellier fut quelque peu cosmopolite. Aux Languedociens du terroir, aux Juifs exilés d’Espagne et de France déjà installés à Lunel, aux Espagnols et aux Salernitains de la première vague, il s’en joignit d’autres à titre d’enseigneurs ou d’élèves.
Le plus célèbre de ces médecins étrangers fut le catalan Arnaldo de Villanova (Arnaud de Villeneuve). Esprit entreprenant et avisé, il fut mêlé à toutes les affaires politiques de son époque, y compris celle des Templiers. Son acitivité médicale mêle malheureusement de façon intime les problèmes métaphysiques et de philosophie à ceux des sciences de la nature animée et inanimée. Ses très nombreux ouvrages médicaux visent à concilier les opinions d’Hippocrate, de Galien, des Arabes et des Salernitains. Mais dans la défense de la vérité, il accorde une voix prépondérante à son expérience personnelle, quitte à rentrer en polémique avec Galien et Avicenne. Villeneuve fut à la fois en harmonie avec son époque et en avance sur elle.
Montpellier a également connu quelques grands noms français; Gilles de Corbeil est venu de Salerne. Henri de Mondeville enseigna à Montpellier avant de devenir le chirurgien attitré de Philippe le Bel et de Louis le Hutin; Enfin, Guy de Chauliac fut en chirurgie ce qu’Arnaud de Villeneuve fut en médecine. Il devint le médecin préféré du pape Clément VI et de ses successeurs, alors en Avignon. Lors de la terrible pandémie pesteuse de 1348 qui ravagea le midi de la France, il en fait une description clinique et épidémiologique saisissante. Il ne parvint malheureusement pas à sauver Dame Laure de Noves, l’épouse d’Hugues de Sade. Cet échec lui valu l’inimitié haineuse et mesquine de Pétrarque, l’illustre poète de la Fontaine de Vaucluse. Il publie à la fin de sa vie la “Chirurgia Magna” qui fit longtemps autorité , reprend et complète toutes les données médico-chirurgicales de l’époque. Chauliac y proclame avec insistance que “tout opérateur doit avoir une connaissance approfondie de l’anatomie en s’instruisant par la dissection de cadavres humains”. Les qualités de son esprit, la noblesse de son caractère, s’expriment dans sa conception du médecin parfait.
Jean d'Alais et Petrus Hispanus qui devint pape sous le nom de Jean XXI.
Illustres élèves
Le Montpellier du Moyen Age a instruit ou accueilli de nombreux médecins parmi les plus grands. Parfois contrebattue à Paris, son influence heureuse s’est fait sentir sur toute la France et au-delà même de nos frontières.L’Ecole de Montpellier s’honore de compter parmi ses élèves Gabriel et François Miron, médecins de Charles VIII, le fameux Nostradamus (1530), Laurent Joubert (1558) et trois anatomistes réputés : Sylvius (1530), Platter (1555), Bauhin (1580). Plus tard Théophraste Renaudot, Pecquet, Vieussens, Sydenham, Boissier de Sauvages et de nombreux autres : Guillaume Rondelet se lia d'amitié avec François Rabelais qui obtint à Montpellier son titre de docteur en médecine en 1537.
Jusqu’au XIème siècle, période de la création des écoles de Salerne et Montpellier, la compétence du médecin s’étend à toutes les parties de l’art de guérir, car la médecine, la chirurgie et la pharmacie sont confondues.
La Renaissance
La Renaissance se caractérise par une rénovation de l'enseignement. De la Renaissance à la fin de l'Ancien Régime, à Montpellier l'enseignement est marqué par la perte progressive de la tutelle cléricale au profit de l'État avec une faculté qui acquiert ses propres locaux vers 1450 : le « Collège royal de Médecine », et de nouvelles règles édictées par le décret royal de Louis XII le 29 août 1498. Cet édifice était situé près de l'actuelle église Saint-Mathieu.
En 1556, la faculté est la première de France à se doter d'un amphithéâtre consacré à l'examen des cadavres. Pendant le règne d'Henri IV l'École de médecine de Montpellier est dotée d'un « Jardin des plantes » dès 1593. Volonté d'un roi, il est l'œuvre du professeur Pierre Richer de Belleval. Premier Jardin Royal de France, antérieur à celui de Paris, il constitue aujourd'hui encore, l'une des plus belles richesses de Montpellier.
Alors que la chaire d'anatomie et de botanique fut créée en 1593, celle de chirurgie et de pharmacie vit le jour en 1597. La chaire de chimie et celle destinée à enseigner aux étudiants à "consulter et à pratiquer" sont instituées en 1673 et 1715, respectivement. La première transfusion de sang fut réalisée le 16 juin 1667 par Denys.
Les guerres de religion vont mettre un terme à cette floraison. Montpellier, en rivalité avec Paris, fournit néanmoins la plupart des médecins du roi (dont François de Lapeyronie).
La période révolutionnaire et l'Empire
Pendant la période révolutionnaire, par décret du 15 septembre 1793, la Convention met un terme à six siècles d'enseignement, dissout les universités et ferme les écoles. Malgré leur lustre international, Université de médecine, et Académie de chirurgie (créée en 1741), sont balayées.
Mais, un an seulement après ce funeste décret, le 4 décembre 1794 (14 frimaire an III), la Convention décrète la fondation de trois Écoles de Santé (Montpellier, Paris et Strasbourg) dispensant un enseignement médical et chirurgical.
Puis le 22 avril 1795, la faculté quitte ses locaux anciens et vétustes pour ses locaux actuels, le monastère Saint Benoît, ancien évêché jouxtant la cathédrale Saint-Pierre. Jean-Antoine Chaptal y fait construire un théâtre d'anatomie. Médecine et Chirurgie sont réunies.
Le décret napoléonien du 11 mars 1803 (19 ventôse an XI) soumet l'exercice de la médecine à l'obtention d'un doctorat. À partir de 1804, la faculté de Médecine se dote d'une bibliothèque prestigieuse, grâce à son bibliothécaire Victor-Gabriel Prunelle.
Un grand amphithéâtre fut créé en 1802, le bâtiment Henri IV en 1838, le bâtiment d'anatomie en 1867, et l'Institut de biologie en 1869 et 1900.
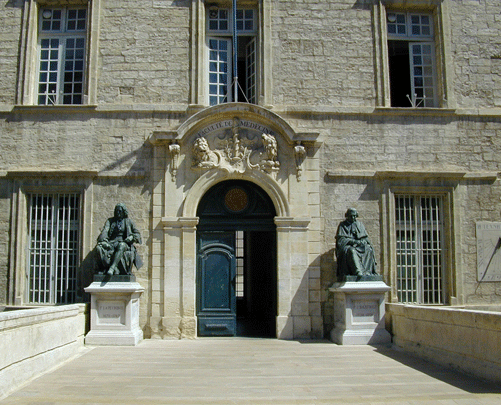
Les statues de bronze de François Lapeyronie (1678-1747) et Paul-Joseph Barthez (1734-1806)
ornent depuis 1864 l'entrée de la Faculté de Médecine de Montpellier.
Cette Faculté, fidèle à sa tradition, conserve une place éminente dans le mouvement médical contemporain.
La Faculté de Médecine de Montpellier renferme la plus riche bibliothèque de France, avec 300000 volumes, deux musées :
Le musée Atger abritant de remarquables collections de dessins de maîtres, régionaux, italiens, flamands de la Renaissance au XIXe siècle.
Le musée d'anatomie, particulièrement étonnant, abrite des instruments chirurgicaux, mais aussi des aberrations de la nature conservées dans du formol.
Laïcisation de la médecine :
Au XIIe siècle, en partie sous l’influence de Salerne, l’église évolue, la dissection du corps humain est autorisée et de nombreux clercs sont appelés à pratiquer la médecine. Ils se passionnent alors pour ce domaine, mettant leur érudition hippocratique au service des malades.
Mais l’église de Rome s’émeut de cette prise d’indépendance et remet de l’ordre lors des Conciles qui vont suivre :
• En 1130, le concile de Clermont et en 1131 celui de Reims tentèrent d’interdire la pratique de la médecine au clergé régulier.
• En 1163, lors du concile de Tours, l'Église décrète : “Ecclesia abhorret a sanguine“ (l'Église hait le sang) ; Avec ce décret, les médecins, la plupart membres du clergé à l'époque, ne peuvent plus pratiquer la chirurgie, et celle-ci est reléguée à un rang inférieur pour de nombreuses années.
• En 1215, le IVe concile du Latran va plus loin et interdit explicitement aux prêtres d'exercer la chirurgie. Cette interdiction de la pratique de la chirurgie par les médecins conduira des professions comme les arracheurs de dents, les marchands forains ou les barbiers à réaliser des interventions de petite chirurgie.
De surcroit, la conception mystique qui s’imposait aux religieux les incitait davantage à assiter les âmes qu’à secourir les corps.
C’est vers cette période, qui coïncide avec la création des premières universités et avec la diffusion de l’enseignement hors des enceintes conventuelles, que la profession médicale revint définitivement aux laïcs. La médecine médiévale prit dès lors une orientation nouvelle, déterminée en grande partie par le précieux apport documentaire venu d’Orient.
L’avancé des croisades fera reprendre alors conscience aux européens de l’ouest (en particulier aux Francs) que face à la civilisation byzantine, ils ont de grands retard, en particulier dans le domaine médical. On découvre en particulier en Palestine des établissements de soins pour blessés de grande qualité. L’orient, contrairement à l’occident, a en effet développé formidablement l’esprit médical et le métier de médecin durant cette période du moyen- age. Le cas d’Abou Ali Ibn Abdillah Ibn Sina dit Avicenne, médecin et philosophe iranien est à ce titre exemplaire. Il est resté célèbre par son “Canon”, qui établit une revue totale de toutes les maladies de l’homme et établit les correspondances entre les qualités du corps, les saisons, les humeurs, les âges et les mouvements de l’âme.
Ce n'est que peu à peu que la médecine devient laïque, mais les "physiciens" ou "mires" qui l'exercent sont astreints au célibat jusqu'en 1452, date à laquelle Guillaume d'Estoutrville obtient en leur nom une dispense pontificale.
La laïcisation de la médecine est le résultat de causes d'ordres différents. En premier lieu, l'éloignement des risques d'invasions permet une certaine stabilité politique qui entraîne une ouverture sur le monde. Les monastères ne sont plus les seuls lieux d'étude et chacun pourra accéder à la connaissance. D'autre part, le médecin devait soigner hommes et femmes, se faire une clientèle et par là même pouvait être tenté de ne pas respecter les principes de chasteté et de pauvreté. C'est ainsi que le ministère du prêtre et l'exercice de la médecine devront être dissociés par ordonnance du pape Honorius IV au XIIIème siècle.
Au XIIIe siècle, les armées catholiques prennent Constantinople aux byzantins confirmant alors la ruine de l’Orient au profit de l’Occident. L’Occident chrétien comprend alors la nécessité de développer le monde des savants et la médecine.
III
Naissance des Universités à l’âge de la scolastique
Le XIIIe siècle marque dans l’histoire de la connaissance et de la pensée humaines une étape dont on peut critiquer les effets immédiats, mais dont on ne saurait nier l’importance. C’est en effet le siècle où éclôt partout en Europe les premières universités. C’est également celui où la doctrine canonique édifie les règles de la pensée et du raisonnement qui pèseront sur la fin du Moyen Age chrétien. Tandis que s’épanouissait la société médiévale, le légitime désir d’apprendre et de s’émanciper du cadre conventuel devenu trop étroit s’était largement répandu dans les milieux laïcs. Il devait aboutir tout naturellement à la création de centrtes d’enseignement autrement conçus.
Conjointement, l’indispensable sauvegarde de l’unité chrétienne exigeait que ce vaste mouvement de pensée fut judicieusement guidé et maintenu dans les limites compatibles avec la foi.
C’est aussi le siècle de trois grands rois : Philippe-Auguste (1165-1223), Louis IX (1214-1270) et Philippe Le Bel (1268-1314). Chacun ayant sa part dans la construction de l’unité française qui mettra fin à la Féodalité. L’Art, les Lettres et les Sciences prennent un essor considérable, qui se traduit par le développement de la langue française, de l’art gothique et des Universités.
A la fin du XIIe et au début du XIIIe naissent de prestigieuses universités, celles de Bologne (1188), celle de Montpellier (1220) et celle de Paris (1215).
En 1252, l'organisation de l'Université en quatre facultés (théologie, droit, médecine et arts) est promulgée. Les grades sont ceux de Bachelier, Licence, Maîtrise, et plus tard Doctorat.
Les écoles de médecine
A l’exemple de Salerne et de Montpellier de nombreuses écoles de médecine font leur apparition à partir de 1250. Certaines ont formé le noyau initial d’un “studium” autour duquel se groupèrent par la suite des Facultés de disciplines diverses. D’autres se sont ouvertes secondairement, au sein d’une Université déjà officiellement reconnue comme centre d’enseignement de la théologie, du droit ou des lettres (c’est le cas de Paris). Etablis ou confirmés par les autorités temportelles et spirituelles, les statuts des jeunes universités variaient notablement d’un pays et même d’une ville à l’autre. Ainsi les universités de Paris et d’Angleterre relevaient directement et exclusivement de l’Eglise. Celles d’Espagne ou de Naples faisaient figures d’institutions d’Etat. D’autres comme celle de Bologne ou de Padoue étaient gérées sur le plan local de la commune qui leur avait donné naissance qui en tirait une légitime fierté et qui, consciente de son propre intérêt, laissait à l’enseignement une relative indépendance.
Directement ou indirectement le pouvoir ecclésiastique n’en conservait pas moins le contrôle des doctrines enseignées : en matière de préservation des dogmes et de surveillance des esprits, il s’en remettait au tribunal spécial de l’Inquisition, dont l’ordre nouveau des Dominicains ne tarda pas à se faire une sorte de monopole. L’église limite encore les avancées vers le savoir, en particulier en imposant la scolastique dans la formation des médecins, c’est à dire un enseignement intégrant les concepts aristotéliciens (et des autres auteurs) mais interprétés par les théologiens dans le respect du dogme. Ceci entraîne une nouvelle stagnation de la connaissance médicale et un immobilisme intellectuel, contraire aux principes d’Hippocrate et d’Avicenne qui prônaient la remise en question du savoir, comme source de progrès.
L’Eglise autorise la lecture des textes médicaux, ainsi l’Evêque Guillaume d’Auxerre en 1222, approuve la lecture des textes d’Hippocrate, d’Aristote, de Gallien et d’Avicenne. Ces auteurs deviennent alors les lectures favorites des étudiants. Les études médicales se structurent. On fait alors passer des épreuves périodiques aux étudiants en médecine sur une période de 5 à 6 ans. Chaque passage de grade est marqué par une cérémonie religieuse.
Depuis un certain temps un vent de mutualisme soufflait sur la France et, dans différents métiers, ouvriers et patrons se groupaient en associations appelées Corporations. Dans chaque corporation on était tour à tour apprenti, compagnon, c’est-à-dire ouvrier et enfin maître, c’est-à-dire patron; les chefs élus de la corporation recevaient le titre de maîtres jurés. Chaque corporation était, au point de vue religieux, affiliée à une Confrérie, placée sous la protection d’un saint ou d’une sainte. Le mot “universitas” désignait à l’origine une corporation “magistrorum et scholarium” à laquelle les autorités accordaient des franchises et des privilèges spéciaux. Il s’est appliqué par la suite au “collège des docteurs” qui possédait à l’égard des étudiants méritants le “jus promovendi”, autrement dit le pouvoir de décerner les diplômes. Le titre de professeur n’a fait son apparition qu’au XVI e siècle.
Enfin, pour faciliter l’enseignement les étudiants se grouperont par affinités d’études.
L’ Université de Paris
Fondée officiellement sous Philippe Auguste (1165-1223) en 1215, l’Université de Paris remontait en fait à une date plus ancienne : Pierre Abélard (1079-1142) y professait déjà au début du XIIe siècle. En 1215, le cardinal Robert de Courson, légat du Pape Innocent III crée officiellement la nouvelle Université. Les lettres du cardinal précisent les privilègues et status de l' Universitas. Ces lettres constitueront en final un seul texte codifiant les relations de l'Université et du monde extérieur, mais aussi les règles intérieures à l'Université (études, grades,...etc). Cette date de 1215 est généralement considérée comme la date de fondation formelle de l' "universitas magistrorum et scolarium parisiensis", la charte de privilèges entérinée par le pape étant signe de reconnaissance suprême pour toute communauté, et la bulle du Pape Grégoire IX de 1231 crée une Faculté de Médecine distincte de la Faculté des Arts, sous le titre de "Saluberrima Facultas Medicinae Parisiensis", la constituant en corporation ecclésiastique. La Faculté a pour principal mission d’enseigner et de faire passer les examens; elle surveille aussi les chirurgiens et les apothicaires et doit être consultée en ce qui concerne l’hygiène publique. Les six médecins exerçant alors à Paris assurent l’enseignement avec le titre de Maîtres régents; les cours commencent dès cinq heures du matin.
Placée directement sous l’autorité pontificale que le Chancelier de Notre-dame exerçait par délégation, l’école cathédrale comptait en 1270 un doyen et six maîtres-régents coiffés d’un bonnet carré, nantis du privilège de battre monnaie et de faire grève ou “cessation”. On évalue à 15.000 ou 20.000 le nombre des élèves qui la fréquentaient alors, et que leurs fêtes turbulentes ou leurs manifestations opposaient souvent aux forces de police. Pendant longtemps, Paris enseigna seulement la théologie; sa Faculté de Médecine est donc créée postérieurement à celle de Montpellier (17 avril 1220).
Elle attira précocement de nombreux étudiants étrangers initialement groupés en quatre “nations” : France, Normandie, Picardie, Angleterre. Les “escholiers” furent bientôt hébergés dans des “collèges” dus à l’initiative privée, comme celui des Dix-Huit fondé par un anglais en 1180, ou celui que le chapelain de Louis IX (Saint Louis), Robert de Sorbon, fit édidfier en 1253 pour la communauté des pauvres maîtres et étudiants en théologie. Purement théorique et scolastique, l’enseignement se donnait dans des maisons privées ou des églises, voire dans des granges meublées de botte de paille ou de foin réservé aux maîtres, notamment rue des Escholliers ou du Fouarre le “vicus straminis”, on sait que la rue du Fouarre, occupée alors par les écoles, ne reçut son nom qu'à cause de la paille ou foin ou feurre à l’époque dont elle était couverte. Suivant les instructions données par le pape Urbain V en 1366, les élèves étaient astreints à “écouter les leçons assis à terre, et non assis sur des bancs, par esprit d’abnégation et pour écarter de leur jeunesse toute tentation d’orgueil”. Le faste et la solennité des cérémonies universitaires n’ôtaient rien à la fatuité puérile et au dogmatisme étroit des professeurs dont les affirmations étaient irréfutables, les sentences sans réplique : maîtres et élèves, d’un commun accord, affichaient le plus profond mépris pour la réalité des faits.
La Faculté de Paris compta peu de grands médecins à cette époque, en dehors des figures illustres de l’Italien Pietro d’Abano, de l’Anglais Roger Bacon, de l’Allemand Albert le Grand qui y ont enseigné entre 1240 et 1300. On a retenu les noms de Gilles de Corbeil, de Jean Saint-Amand, de Pons de Saint-Gilles, de Géraud de Bourges, et du Portugais Pierre Julien dit l’Espagnol qui devait devenir Jean XXI, tous élèves de Salerne ou de Montpellier.
L’Université de Paris servit de modèle à la plupart des universités d’Europe centrale. Pour des raisons politiques, les étudiants anglais qui la fréquentaient en grand nombre, furent expulsés par ordonnance royale en 1167 : de retour dans leur pays , ils contribuèrent grandement à la naissance et au développement de l’Université d’Oxford.
Pitard et Lanfranc. Le Collège de Saint-Côme.
Les chirurgiens n’étaient pas encore admis au sein de la Faculté : ils formaient le Collège indépendant de Saint-Côme et Saint Damien fondé en 1260 par Jean Pittard compagnon de Louis IX à la croisade.
Les premiers statuts retrouvés de cette confrérie de tous ceux qui “s’entremettent de chirurgie” datent de 1379, ceux de J. Pitard (rédigés par le prévôt de Paris Etienne Boislève (1210-1270), dans son Livre des Mestiers, rédigés sur des parchemins roulés, puis copiés en cahiers et enfin reliés) ne sont pas parvenus jusqu'à nous, mais il en est fait mention. Après avoir rappelé les devoirs dus aux trépassés - messes, prières et cierges offerts par la confrérie. Il est dit que les chirurgiens ne pourront s'assembler sans l'autorisation des "jurez", ils devront se réunir à Saint Jacques de la Boucherie ; les chirurgiens de la confrérie s'engagent à payer une certaine somme pour être agréés et ne doivent pas révéler la teneur des examens. Les confrères se doivent mutuelle assistance, ils reçoivent le "bonnet magistral au chapitre de l'Hôtel-Dieu de Paris", il est fait expressément mention de la connaissance requise du latin : ni les maîtres ni les bacheliers ne peuvent prendre un apprenti s'il n'est grammairien et ne sait le latin car, précise l'article 30, "la science de chirurgie pourrait autrement venir à néant". Mais les barbiers outrepassent leurs droits et font des opérations réservées aux seuls chirurgiens.
La première personnalité éminente de ce Collège fut un Italien, exilé de Milan en 1290 pour avoir pris parti dans la lutte des Guelfes et des Gibelins : Guido Lanfranchi dit Lanfranc. Réfugié à Lyon, puis à Paris, cet élève de Saliceto y composa et publia en 1298 sa “Chirurgia Magna”, ouvrage remarquable qui fit connaître en France les techniques opératoires brillamment développées en Italie du Nord. Admis parmi les membres de la Confrérie parisienne de Saint-Côme et Saint-Damien, Lanfranc déplore le rôle concédé aux simples barbiers et se prononce en faveur d’une unité médicale : “Nul ne peut être bon médecin s’il ignore les opérations chirurgicales, de même que nul ne peut opérer s’il ne connaît la médecine. O Dieu, pourquoi existe-t-il une différence entre le physicien et le chirurgien ? Les physiciens ont abandonné les opérations aux laïcs et le vulgaire regarde comme impossible que le même homme puisse connaître à la fois la médecine et la chirurgie !”
Il est certain que Jean Pitard aura une très heureuse influence sur les chirurgiens de son époque, qui chercheront à s’instruire le plus possible pour se distinguer des barbiers et se rapprocher des médecins.
Ce dualisme entre médecins et chirurgiens de Paris se prolongea jusqu’en 1515.
Les Facultés de Province en France au Moyen Age
Dans le reste de la France, le nombre des Facultés de Médecine créées au Moyen Age n’a pas été inférieur à quatorze, celle de Montpellier non comprise. La plupart se situaient dans le midi de la France. En 1216, Raimond VI, comte de Toulouyse dota sa ville d’une école médicale dont la direction fut confiée à un médecin israélite venu d’Espagne, Lopez Hispanus. Raymond de Sebonde, Astruc et Larrey y feront leur études).
Fondée en 1303, la Faculté d’Avignon ne fut en fait qu’une annexe de celle de Montpellier. Celle d’Orange (1365) est connue pour avoir accueilli au XVIIe siècle le médecin Moïse Charas. Cahors (1332), Grenoble (1339), Perpignan (1349), n’ont pas marqué l’histoire de la médecine. A Angers (1356), Denis Papin laissera le souvenir d’un élève brillant. Puis vinrent Aix-en-Provence (1409), Dole (1423), Poitiers (1431), Caen (1438), Bordeaux (1441), Valence (1452), et Nantes (1459), toutes supprimées par la loi révolutionnaire du 23 septembre 1793.
L’université de Bologne
Bologne sera comme Paris, un centre de scolastique rigide. Fondée en 1123, l’enseignement médical y fut inauguré en 1250 et groupait déjà 47 professeurs. La ville y consacrait la moitié de son budget. Sa première orientation fut surtout chirurgicale avec Ugo Borgognone et Guglielmo Saliceto. La première dissection humaine a sans doute eu lieu à Bologne en 1281; vite freinée par une bulle du pape Boniface VIII frappant d’excommunicationles “découpeurs de cadavres”.
Mondino dei Luzzi, Florentin d’origine, fut nommé lecteur d’anatomie à Bologne et restait en gros fidèle aux descriptions galéniques, accomodées d’une nomenclature arabe et accompagnées de quelques allusions à la physiologie ou à la pathologie. Mondino eut de nombreux élèves;
Taddeo Alderotti enseigna à Bologne à partir de 1260 et rédige un manuel de conseils d’hygiène “ De la conservation de la sant” , inspirés de ceux de l’école de Salerne.
L’Université de Padoue
A l’opposé, l’Université de Padoue, créée en 1228 et encouragée par la Sérenissime République Vénitienne, se laissera comme celle de Montpellier, pénétrer par le premier souffle d’humanisme médical né chez les Grecs remanié et renforcé ultérieurement par les Arabes. Il y régnait une grande liberté d’esprit. L’enseignement y passa même pour hérétique surtout au temps de Pietro d’Abano, celui-ci chercha à établir un compromis lucide entre la pratique médicale telle que l’avaient développée les Orientaux et la philosophie spéculative traditionnelle. Il avait étudié Aristote et Galien dans leurs textes originaux. Professeur de médecine à Padoue en 1306, son sens clinique et thérapeutique inspiré d’Avicenne et d’Averroès avait fait de lui un praticien très recherché. Abano se risquait parfois à critiquer la philosophie théologique chrétienne, ce qui lui valut d’être poursuivi par l’Inquisistion à deux reprises. et condamné au bûcher à titre posthume.
De nombreuses autres universités se créèrent en Italie au XIIIe et au XIV e siècles.
Autres Universités en Europe
Cette véritable fièvre universitaire qui caractérise les derniers siècles du Moyen Age s’est répandue dans de nombreux pays.
Dans la péninsule ibérique (Palencia, Salamanque, Valladolid, Lérida et Cïmbre. En Angleterre, Oxford et Cambridge. Puis un peu plus tardivement dans les pays germaniques ou flamands etenEurope Centrale et du Nord.
A la fin du XV esiècle, l’Europe possédait au total quatre-vingts centres laïcs d’enseignement, dont dix-neuf en France. Tous ne comprenaient pas cependant une école de médecine.
Le pouvoir de nommer des docteurs était initialement réservé à “ces deux moitiés de Dieu, le Pape et l’Empereur”; vers le début du XVI e siècle, ce droit s’étendit également aux princes et aux comtes palatins.
La scolastique
Mais l’église limite encore les avancées vers le savoir, en particulier en imposant la scolastique dans la formation des médecins, c’est à dire un enseignement intégrant les concepts aristotéliciens (et des autres auteurs) mais interprétés par les théologiens dans le respect du dogme. Ce vaste mouvement est pourtant demeuré désespérément stérile du moins en ce qui concerne le développement des sciences de la nature et de l’homme.
La plupart des érudits du Moyen Age ont entretenu une confusion constante entre deux méthodes pourtant très différentes dans leur principe comme dans leurs indications : d’une part, le rationalisme dialectique ou induit, qui est à la rigueur applicable à la métaphysique; d’autre part, l’étude des phénomènes sensibles appartenant au monde physique, qui ne peut se déduire au départ que de l’observation objective.
Ainsi le siècle éminemment spiritualiste que fut celui de Saint Louis s’honore d’avoir vu naître trois grands doctrinaires puissants, également savants et philosophes : Roger Bacon, Albert le Grand et Thomas d’Aquin.
La médecine à la fin du Moyen Age
A la fin du Moyen Age, le praticien vivant à l’époque de la guerre de Cent Ans, n’en savait guère plus que ses confrères du temps de Galien. La pathologie n’avait pas mieux progressé que l’anatomie et la physiologie. La santé résultait de l’harmonie entre les quatre “tempéraments” principaux et la maladie procédait d’un trouble dans l’une des humeurs principales : le sang, le phlegme, la cholère et la mélancolie, auxquelles Arnaud de Villeneuve avait adjoint un fluide vital ou “spiritus”.
Le diagnostic se faisait sur l’allure de la fièvre, les caractères du pouls, l’aspect des epectorations, du sang et surtout des urines.
La thérapeutique se cantonnait dans un empirisme figé; la saignée, les purgations, les clystères, les ventouses, les sangsues, les vésicatoires; application de moutarde ou de cantharide; installation de sétons au cou; cautérisation au fer rouge; enfin recours à la “fontanelle” (incision scarifiante maintenue béante par l’introduction d’une fève ou d’un pois entre les lèvres de la plaie. La thérapeutique par les “simples” occupait une place prééminente, d’où un regain d’intérêt pour la botanique, en se souvenant des “hortuli” des moines bénédictins.
Contrairement à une opinion répandue; l’hygiène figurait parmi les grandes préoccupations des gens du Moyen Age; la diététique connut également une grande faveur pendant l’époque médiévale.
Suivant une tradition continue depuis l’Antiquité et perpétuée en Orient, l’ésotérisme tenait une place très importante dans la médecine médiévale. Les procédés magiques étaient couramment employés. On attribuait des vertus thérapeutiques aux amulettes, à certaines pierres, aux sécrétions animales, ainsi qu’aux substances et objets les plus étranges. La fameuse “thériaque” imaginée par le médecin de Néron, était toujours appréciée et prescrite.
Thériaque : Composée de chair de vipère et d’une soixantaine d’autres substances hétéroclites patiemment broyées, elle était généralement préparée par un collège mixte de médecins et de pharmaciens solennellement réunis sous le contrôle des pouvoirs publics. Chaque pays, chaque ville en établissait jalousement une formule pariculière : Venise et Bologne, par exemple, étaient renommées pour la qualité et l’efficacité de leur mixture
Portée sur le terrain de la mystique chrétienne, cette croyance générale aux interventions surnaturelles explique la dévotion réservée à certains saints dont l’intercession était réputée souveraine et spécifique d’une maladie déterminée. Le culte des reliques, l’appel aux exorcismes, le traitement des écrouelles par le “toucher royal” s’inspiraient de tendance analogue ("le roi te touche, Dieu te guérisse").
Les médecins restent en pratiques peu efficaces. Les grandes épidémies de lèpre sévissent jusqu’au XVe siècle et ce ne sont que des décisions de police qui en viennent à bout par l’enfermement dans les léproseries ou maladreries. La variole et la peste procèdent elles aussi par poussées.
La querelle des chirurgiens et des barbiers
Au début du Moyen Age, ce sont les moines-médecins qui eurent les premiers l’idée de se décharger sur le barbier du couvent d’une partie de leur travail; le médecin du Moyen Age se bornait à donner des conseils et à poser des indications, sans jamais œuvrer par lui-même “cum ferro et igne”, ainsi qu’il en prenait d’ailleurs l’engagement solennel à l’issue des examens de licence. Il se déchargeait de ces tâches dégradantes sur le chirurgien à robe longue et sur le barbier à robe courte.
L’importance du barbier, dénommé “rasor et minutor sanguinis” s’affirma surtout à partir du XIIe siècle. Outre la tonsure, les attributions du barbier, sous la direction du moine-médecin, comprenaient : la chirurgie courante et surtout la petite chirurgie, appliquant les ventouses et les cautères, saignant et ouvrant les abcès, pensant les plaies, réduisant les fractures et les luxations, soignant les entorses, et pratiquant les extractions des dents, vendant divers onguents, organisant des bains, qu’il effectuait dans une échoppe portant en enseigne trois bassins.. Plus tard, les chanoines médecins et les médecins laïcs imiteront les moines et c’est ainsi que peu à peu la chirurgie se sépara de la médecine et tomba entre les mains des barbiers.
Méprisé pour son ignorance du latin autant que par son humble condition, le barbier trouvait difficilement à s’instruire dans les ouvrages classiques. Cette lacune sera comblée plus tard grâce à l’imprimerie, qui permettra des éditions à bon marché et en langue vulgaire.
Ainsi, paru à Lyon en 1485, sous le titre de Guidon, une vulgarisation de l’œuvre de Guy de Chauliac en français, cette langue dont Ambroise Paré dira cent ans plus tard qu’elle est “autant noble que nulle autre estrangère”.
Les barbiers de Paris, au nombre de quarante, s’étaient érigés en une “Communauté” officiellement reconnue et protégée : “Le premier Barbier et valet de chambre du Roy est Garde du mestier des Barbiers de la ville de Paris … et chef de toute la Barberie et Chirurgie du Royaume”. Leur droit à l’exercice était subordonné à un examen passé devant quatre experts jurés (1311).
La chirurgie et les spécialités médicales
La chirurgie ne fera pas de progrès notables avant Ambroise Paré, et tant que les anatomistes de la Renaissance ne lui auront pas ouvert des possibilités nouvelles.
Quelques opérateurs de talent exercèrent en pays germaniques; les traumatismes et blessures de guerre leur fournissaient un vaste champ d’expérience. En fait les opérations étaient relativement simples et grevées d’une lourde mortalité; et les interventions importantes décrites dans les livres étaient rarement pratiquéeset restaient du domaine de la théorie pure.
L’obstétrique était du ressort des sages-femmes; la pédiatrie n’était quasiment pas représentée; L’opération de la cataracte était parfois réalisée selon la technique des auteurs arabes; les premiers verres correcteurs furent réinventés vers 1280 (Frère Alessandro della Spina et Salvino degli Armati).
Malgrè des tentatives à édicter des mesures relatives à la santé publique (trafic des poisons, réglementation des sépultures), l’hygiène n’en demeurait pas moins déplorable tant dans les cités florissantes que dans les campagnes reculées.
Les hôpitaux
Le nombre des hôpitaux s’était accru sous l’impulsion des Ordres Hospitaliers et grâce à l’inititive des souverains ou des municipalités. Mais leur organisation matérielle laissait beacoup à désirer; Ils ressemblaient davantage à des sépôts de malades qu’à des établissements adaptés aux exigences de la thérapeutique et de l’hygiène alimentaire. Les patients étaient groupés dans une salle commune servant de chapelle, dans la plus étroite promiscuité, à raison de plusieurs dans un même lit à courtines. A l’hôpital de Tonnerre , la salle commune mesurait 101 m de long. Le confort hospitalier ne s’améliora pas davantage aux hospices de Beaune qu’à l’Hôtel-Dieu de Paris.
L’enseignement médical
En 1369, le nombre des étudiants ayant augmenté, la Faculté de Médecine achète au coin de la rue de la Bûcherie et de la rue des Rats (actuelle rue Colbert), une maison qu’elle agrandira plus tard par l’achat des maisons voisines. La bibliothèque ne renferme à l’époque qu’une vingtaine de volumes. Le bâtiment abritant la Faculté de Médecine ne put ouvrir ses portes que le 5 mars 1481.
En 1413, les Maîtres régents prennent le titre de Docteurs régents; ils sont maintenant plus de trente, car tous les médecins de Paris reçus docteurs font partie de droit de la Faculté; tous les deux ans on élit parmi eux les professeurs et les examinateurs, car on n’admet pas qu’un professeur puisse être à la fois juge et partie.
Pour être admis à la Faculté les étudiants doivent avoir le diplôme de Maître des Arts, qui correspond à peu près au baccalauréat d’aujourd’hui; ils doivent aussi être catholiques. Ils sont une quinzaine par année;
La base de l’enseignement de Médecine était l'étude :
• des "choses naturelles" (l'anatomie et la physiologie),
• des "choses non naturelles" (l'hygiène et le régime),
• des "choses contre nature" (la pathologie et la thérapeutique).
Le costume fait son apparition: pour les leçons les professeurs portent la longue robe noire, le rabat, l’épitoge écarlate sur l’épaule et le bonnet carré; dans les cérémonies publiques ils portent, par dessus la robe, un manteau rouge à pèlerine de fourrure.
Saint Luc est devenu le patron de la Confrérie des médecins et le 18 octobre de chaque année, la messe de Saint Luc annonce la rentrée des cours.
Les études médicales duraient quatre ou cinq ans voire davantage. Pour être bachelier en Médecine, il fallait, après avoir été quatre ans maître ès Arts dans l'université, faire deux ans d'étude en Medecine et subir un examen, après quoi on était revêtu de la fourrure pour entrer en licence. D'après les statuts de 1600, on ne reçoit les bacheliers en médecine que de deux ans en deux ans. Cette réception se fait vers la mi-carême. Le candidat passe un examen puis prête serment. Les bacheliers en médecine ne peuvent exercer dans la ville ou les faubourgs de Paris qu'avec l'assistance d'un docteur.
D'étape en étape, un apprenti médecin était successivement un bachelier, un bachelier émérite, un licenciendaire, un licencié et, enfin, pour quelques privilégiés seulement, un docteur-régent.
Le doctorat donnait ensuite celui d’enseigner et de porter bonnet carré : il était soutenu en grande pompe au son des cloches et moyennant le versement d’une taxe à l’Eglise; ces dispositions rigoureuses n’empêchaient cependant pas nombre de personnages médiocres d’accéder à la profession. Le charlatanisme médical fut effectivement une des plaie sociale du Moyen Age.
La clause de célibat a été retirée depuis 1600.
L’exercice de la médecine
Consultants réputés ou simples praticiens, médecins de cour ou de municipalités pouvaient prétendre à des honoraires substanciels. Ils soignaient néanmoins gratuitement ou pour le compte des communes, un grand nombre de malades peu fortunés. L’incompétence de certains praticiens dûment diplômés n’échappait pas au public, surtout des plus cultivés ce qui soulevait l’indignation de nombre de leurs contemporains.
Bilan de la médecine médiévale
Les médecins du Moyen Age ne méritent pas le discrédit collectif et les critiques sans appel dont on les accable généralement. La plupart d’entre eux manquaient certes de discernement rationnel, d’esprit scientifique et de méthode de travail. Ils souffraient surtout d’avoir été exclusivement instruits, et à la lettre, par les livres momifiés d’Hippocrate, de Galien, d’Avicenne, d’Averroès ou de Rhazès. Ils n’étaient pas entièrement responsables de leur immobilisme technique. Ils n’en témoignaient pas moins d’une universalité qui leur permettait de fondre dans un même creuset les trois grands courants parvenus jusqu’à eux, à savoir la survivance du savoir gréco-romain, la doctrine chrétienne et l’apport oriental, ce qui éveilla la curiosité de l’humanisme intellectuel et prépara la voix aux initiatives futures.
Entre le XIe et le XVe siècle, Les médecins restent en pratiques peu efficaces. Les grandes épidémies de lèpre sévissent jusqu’au Xve siècle et ce ne sont que des décisions de police qui en viennent à bout par l’enfermement dans les léproseries ou maladreries. La variole et la peste procèdent elles aussi par poussées. La grande peste de Marseille atteste en 1348 de la faiblesse de la médecine. Ceci entraîne la résurgence des pèlerinages, des rites pieux, des flagellations et des processions.
Il manque à la médecine des approches thérapeutiques efficaces. Les médecins privilégient alors d’une part la botanique et d’autre part l’astrologie dans une conception cosmique de l’homme et de la maladie. Ils se rapprochent dès lors des apothicaires. On recherche les vertus des plantes de manière active du XI au XVe siècle. Cette période de règne de la médecine couplée aux apothicaires perfectionne grandement la connaissance de la botanique et complète l’œuvre du naturaliste Pline l’ancien (23-79 après JC, auteur d’une célèbre "histoire naturelle").
Mais la connaissance même parfaite des plantes n’aide pas à traiter les grands fléaux. La laitue sauvage traite les infections de l’œil, les sucs de fleurs remédient à la jaunisse, la mandragore passe pour un puissant aphrodisiaque, mais les grandes épidémies et les famines persistent. On ne sait pas encore comment bien conserver les aliments qui donnent de fréquentes intoxications. L’ergotisme en est un exemple, causé par le poison de l’ergot, champignon qui parasite le seigle et entraîne des atteintes artérielles allant jusqu’à la gangrène et l’amputation spontanée dans le meilleur des cas. La seule réponse de la thérapeutique médiévale sont les bains et… des dévotions et pèlerinages dédiés à Saint Antoine, qui assurèrent la prospérité des communautés des Antonins.
Ainsi à la fin du XVe siècle, les médecins doivent plus leur diplôme à la théologie, à l’astronomie, à la botanique et à l’astronomie qu’à l’art médical.
La transition entre le Moyen Age et la Renaissance ne s’est pas opérée brutalement. Cette évolution de la médecine, des autres sciences et de la pensée en général, ne s’est pas amorcée ni déroulée simultanément dans tous les pays. Elle a été plus précoce en Italie, où la fin du Moyen Age se situe vers 1350, que dans le reste de l’Europe qui prit un retard de oprès d’un siècle et demi.
Depuis les origines du genre humain, la science médicale, telle que nous la concevons de nos jours, est demeurée trop primitive , trop rudimentaire et trop partielle pour que sa chronique fasse véritablement figure d’histoire. Il ne s’agit en fait que d’une tentavive d’histoire, édifiée sur des connaissances fragmentaires, souvent érronées; elle se résume dans une liste de quelques grands médecins dont les louables éfforts étaient tour à tour irréductiblement paralysés.
La Renaissance va ouvrir une ère nouvelle qui se prolongera jusqu’au début du XIX e siècle. La lmédecine rentrera alors dans une période de transformation féconde qui la conduira enfin à maturité. Telle la chrysalide, elle laissera peu à peu transparaître sa forme définitive: celle d’une science singulière, à nulle autre semblable, et qui ne cessera jamais tout à fait d’être un ART.